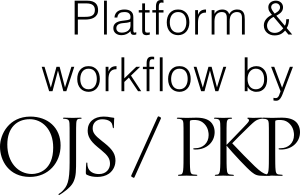UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Av. Juárez No. 976, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México
Av. Juárez No. 976, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México
Contacto
verbum@administrativos.udg.mx

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Verbum et Lingua ISSN 2007-7319